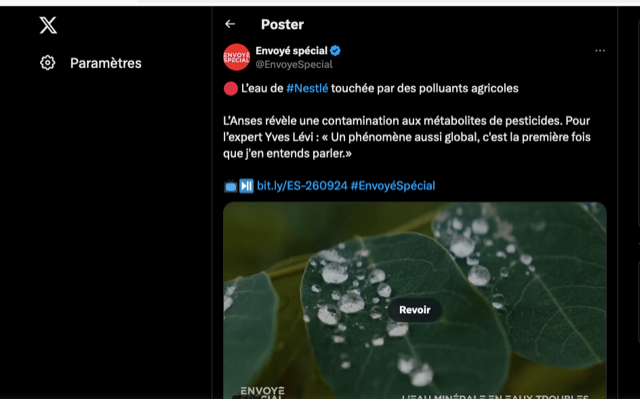Je n’aime pas le journaliste Patrick Cohen. Je ne le déteste pas, je ne l’aime pas. En septembre 2019, je suis passé dans une émission de télé apparemment très populaire, « C à vous ». Apparemment, car je n’ai pas la télé. Cohen en est un des chroniqueurs attitrés. Je venais parler de mon dernier livre, Le crime est presque parfait , dans lequel je décrivais les dangers d’une nouvelle classe de pesticides, les SDHI. Mon travail était appuyé, pour ne pas dire validé par des travaux scientifiques de haute volée, notamment ceux de Pierre Rustin, chercheur de renommée internationale.
Le principe de ces émissions de promotion est immuable. On vient vendre sa petite marchandise, un(e) journaliste pose des questions plus ou moins avisées, et l’on rentre à la maison. J’exècre cet exercice, depuis toujours. Mais ce jour-là fut différent, car l’on m’avait tendu un guet-apens. Cohen, en tout cas, qui est je le rappelle concentré à 100% – disons 99% – sur la politique politicienne. Il a l’air d’aimer cela.
Je commençai à parler de mon livre et c’est alors que, lisant des pages devant lui, il m’attaqua de front. Si cela avait porté sur mon travail, j’en aurais été satisfait. Très. Car j’aime le débat et même la polémique. Mais tel n’était pas le cas. Cohen n’avait bien entendu rien lu de mon livre, dont il n’a que faire. Il cherchait à me discréditer. À me disqualifier. Et il parla des pesticides en général, qui selon lui, n’étaient nullement un danger. Il défendait le glyphosate, les néonicotinoïdes, estimant que les paysans seraient morts depuis longtemps s’ils étaient aussi dangereux que le prétendent les écologistes de mon espèce.
J’en fus déstabilisé. Pour la raison de fond qu’un plateau télé, en direct, est un dispositif scénique sur lequel un invité comme moi n’a aucune prise. Les chroniqueurs maîtrisent le temps comme l’espace, et en la circonstance, j’étais obligé de répondre en accusé à des « infos » – le guillemet s’impose – que lisait doctement Cohen, l’un des rois de l’émission. D’où venaient-elles ? Quelles étaient-elles ? Je n’en savais rien. J’avais droit à une petite poignée de minutes dont j’avais déjà épuisé l’essentiel, et il m’aurait fallu une demi-heure pour démonter la pauvre argumentation de mon assaillant. Car elle était consternante, bien sûr. Que sait un Cohen d’un sujet que je suis avec constance depuis près de trente ans ? Auquel j’ai consacré plusieurs livres ? Il en sait si peu que cela l’intéresse moins que la coupe de cheveux du nouveau Premier ministre. Alors ?
La situation était si inhabituelle que la présentatrice de l’émission, la très connue Anne-Cécile Lemoine, a couru derrière moi alors que j’avais déjà quitté le studio. Elle avait l’air mal. Elle s’est excusée pour ce qui venait de se passer, et comme je la sentais sincère, j’ai préféré laisser tomber. Je lui ai dit que cela n’avait pas d’importance. D’un côté, c’est vrai, l’incident était dérisoire. Mais de l’autre, il signifiait bel et bien quelque chose.
Pour finir, je vais faire très attention, car la loi sur la diffamation l’exige. Et c’est d’ailleurs très bien à mes yeux. Vous lirez ci-dessous un article dérobé au journal Le Monde de ce jour. Je le sais, ça ne se fait pas, et le plus généralement, je ne le fais pas. Si je fais exception, c’est parce qu’il décrit avec force détails un système mondial de désinformation au profit de l’industrie des pesticides. Mondial, donc français. Vous verrez, si vous lisez, l’ampleur stupéfiante des manipulations. Des journalistes acceptent, consciemment ou pas, de relayer la pure propagande de l’agrochimie. Avec un peu d’habitude, il n’est pas si difficile de retrouver les traces de cette opération géante dans le champ public, en France ou ailleurs.
Patrick Cohen en est-il ? Je n’en sais strictement rien, et c’est sincère. Je ne veux pas même insinuer que c’est le cas. Je crois même qu’il peut être sincère, comme ces crétins de climatosceptiques qui, depuis des décennies, adorent montrer leur indépendance d’esprit en enfourchant les billevesées de l’industrie pétrolière. Que ne ferait-on pour se faire remarquer ?
Oui, Cohen est peut-être sincère. Et oui, peut-être n’a-t-il rien à voir avec cette si sombre affaire. Le fait est, en tout cas, qu’il reprend des « arguments » industriels mille fois controuvés. Qui lui fournit les fiches qu’il utilise si complaisamment à l’antenne ?
Et je me pose les mêmes questions au sujet d’au moins deux journalistes. L’une qui travaille dans un quotidien, l’autre dans un hebdomadaire qui a longtemps laissé Claude Allègre y déverser ses impostures climatiques. Derechef, elles sont peut-être sincères. Derechef, qui fournit le matériau ?
———————————————————–
L’article de ce jour dans Le Monde
Plongée dans la boîte noire de la propagande mondiale en faveur des pesticides
Par Stéphane Foucart, Elena DeBre et Margot Gibbs (Lighthouse Reports) Publié aujourd’hui à 06h58, modifié à 11h24
Temps de Lecture 11 min. Read in English
Article réservé aux abonnés Offrir l’article Ajouter à vos sélections Partager
- Partager sur Twitter
- Partager sur Messenger
- Partager sur Facebook
- Envoyer par e-mail
- Partager sur Linkedin
- Copier le lien
Enquête« Bonus Eventus files » (2/3). Créée par l’ancien directeur de la communication de Monsanto, Jay Byrne, la plate-forme privée Bonus Eventus fournit à ses membres, recrutés par cooptation, une vaste base d’arguments favorables à l’agrochimie destinés à influencer le débat public, révèlent « Le Monde » et un collectif de médias.
source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-00-lm-styles.txt source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-00-styles.txt source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-00-structure.txt source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-00-texts.txt source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-01-structure.txt source https://assets-decodeurs.lemonde.fr/doc_happens/240926-poison-files/240926-pf-01-texts.txt
Ce n’est pas tous les jours qu’une bonne idée surgit. Le 11 mars 2010 au matin, Jay Byrne envoie un courriel à l’un de ses contacts réguliers,Bruce Chassy, professeur de nutrition à l’université de l’Illinois et grand défenseurdes biotechnologies. Ancien directeur de la communication de Monsanto et patron d’une petite société de relations publiques dénommée « v-Fluence », M. Byrne présente à son correspondant un « bien meilleur concept » que les idées qui circulent alors pour défendre, dans le débat public, les intérêts de l’agro-industrie.
« Je suis en train de dresser une liste “d’opportunités”, avec des cibles comme Vandana Shiva [militante écologiste indienne], Andrew Kimbrell [avocat et militant pour une alimentation saine] et Ronnie Cummins [défenseur de l’agriculture biologique], écrit M. Byrne. Et des organisations comme Greenpeace, le Sierra Club [association de défense de l’environnement](…), ou des contenus comme Food, Inc.[documentaire critique sur l’agro-industrie], Le Monde selon Monsanto [livre, La Découverte, en 2008, et film de la journaliste Marie-Monique Robin], In Defense of Food [livre de Michael Pollan, non traduit]. » M. Byrne souhaite, explique-t-il en substance, remettre en selle un vieux projet qu’il avait élaboré pour Monsanto. Un système « qui répertorie tous les sujets d’attaques contre les biotechnologies agricoles, les auteurs de ces attaques et les éléments de réponse disponibles ». « Toutes ces personnes, organisations, éléments de contenu et domaines thématiques, cela vaut de l’argent pour toute une série de sociétés bien loties », se félicite par avance M. Byrne.
Obtenu grâce à la loi américaine sur l’accès à l’information (Freedom of Information Act), ce courriel de 2010 est la première trace écrite connue d’un projet de plate-forme en ligne destinée à influencer le débat public sur les pesticides et les organismes génétiquement modifiés (OGM). Elle a été baptisée « Bonus Eventus », personnification divine de l’agriculture chez les Romains, et dont la traduction est peu ou prou « issue favorable ». Dans ses échanges avec ses clients, v-Fluence fait aujourd’hui miroiter l’accès à cette « base de donnéesexclusive », bâtie autour d’un « réseau social privé » rassemblant des centaines d’experts, de consultants, de cadres de l’industrie chimique, tous acquis à la cause des pesticides et des biotechnologies. Et tous profitant ainsi d’un accès à une vaste base documentaire, avec fiches détaillées sur les personnalités « critiques », et fiches thématiques garnies d’éléments de langage préfabriqués.
Minimiser les dégâts des intrants de synthèse
Des documents internes de la plate-forme, obtenus par le média d’investigation Lighthouse Reports, partagés avec Le Monde et d’autres médias internationaux, dévoilent pour la première fois les coulisses de ce réseau qui cible ses adversaires, produit et diffuse des arguments minimisant les dégâts des intrants de synthèse sur la santé et l’environnement, et met en doute le consensus scientifique sur le caractère non durable du modèle agricole dominant. La campagne est mondiale et la France, grâce à quelques titres de presse et une poignée de consultants et blogueurs, n’est pas épargnée.
Newsletter « Chaleur humaine » Comment faire face au défi climatique ? Chaque semaine, nos meilleurs articles sur le sujet S’inscrire
N’y entre pas qui veut : le ticket s’obtient par cooptation. Interrogé, Jay Byrne explique que « l’accès est donné sur recommandation ou invitation d’autres membres du réseau ». Selon les documents consultés par Le Monde, environ un millier de personnes ont obtenu l’accès à la plate-forme. Parmi eux, sans surprise, des cadres de Syngenta, Bayer, BASF, Corteva et du syndicat des fabricants de pesticides, CropLife. Mais aussi une trentaine de fonctionnaires en poste au ministère américain de l’agriculture (US Department of Agriculture, USDA) ou au département d’Etat (l’équivalent du ministère des affaires étrangères).
Lire l’enquête (en 2020): Article réservé à nos abonnés Pesticides interdits : révélations sur l’intense lobbying des industriels jusqu’au sommet de l’Etat
Parfois au plus haut niveau, comme en témoigne la présence de Kip Tom, représentant des Etats-Unis à l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) entre 2019 et 2021. Interrogé, M. Tom répond qu’il n’est « ni membre ni affilié » à Bonus Eventus. Les documents consultés par Le Monde indiquent toutefois que son profil a été complété et mis à jour sur la plate-forme.
Un registre de plus de cinq cents fiches
Une part importante des inscrits sont consultants, blogueurs, experts, journalistes, etc. Parmi eux se trouvent des personnalités occupant ou ayant occupé des positions influentes dans des groupes d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, le GIEC de la biodiversité), à la tête du service australien d’homologation des pesticides, au ministère de l’agriculture du Kenya ou au sein du service national de biosécurité de ce même pays, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, etc. Plus de soixante nationalités sont représentées. On trouve des Américains (450), des Canadiens (43), des Kényans (43), des Suisses (29), des Britanniques (29), des Allemands (20), des Français (16) et bien d’autres.
La plupart des titulaires d’un compte que Lighthouse Reports, Le Monde et leurs partenaires ont interrogés assurent n’avoir aucun lien avec Bonus Eventus ou v-Fluence, et ne pas être membres d’un quelconque « réseau social privé ». La grande majorité disent s’être simplement inscrits à un service de revue de presse et assurent ne pas participer aux activités de ce réseau, ne pas consulter sa base documentaire mise à disposition des inscrits, etc. Bonus Eventus ne produit pas seulement du doute sur la réalité des effets des pesticides pour la santé et l’environnement : le réseau entretient aussi le flou sur son étendue réelle, en mêlant dans son registre des membres actifs et de simples abonnés à ses newsletters.
Beaucoup d’inscrits disent ainsi ignorer que Bonus Eventus dispose d’un registre de plus de cinq cents fiches sur des personnalités critiques de l’agriculture intensive (scientifiques, militants écologistes, experts des Nations unies, journalistes, etc.) – fiches qui agrègent pour chacun d’eux des rumeurs malveillantes, des informations professionnelles ou privées, parfois intimes, généralement de nature à leur nuire ou à leur porter préjudice.
Fournir des éléments de langage
Des fiches thématiques sont également mises à disposition, souvent afin de fournir des éléments de langage ou des arguments en réponse à des critiques : « nouvelles innovations en sélection des plantes », « pesticides : sûrs, nécessaires, universels », « question du glyphosate dans le lait maternel », « technologie de traitement de semences », etc. Certaines fiches apportent des réponses à des objections d’une tout autre nature : « OGM et judaïsme », « OGM et Eglise catholique » (huit pages d’interprétation de la Genèse et de plusieurs encycliques, pour conclure qu’« en général, il est accepté que la science des OGM est théologiquement justifiée »).
Par exemple, la fiche « population mondiale d’abeilles » indique que le déclin de ces pollinisateurs est largement dramatisé. « Les populations globales d’abeilles, en particulier d’abeilles domestiques, sont-elles en catastrophique déclin comme cela est souvent dit par les médias et des groupes d’intérêt ?, lit-on dans cette fiche. Les données de sources gouvernementales qui font autorité suggèrent que c’est peut-être exagéré, sinon faux. » Suivent les statistiques du nombre de colonies déclarées par les apiculteurs dans plusieurs pays, indiquant une hausse du nombre de ruches.
« Le nombre de colonies d’abeilles domestiques déclarées ne dit rien de l’état de santé des abeilles, décrypte l’apidologue Gérard Arnold (CNRS). Il est facile aux apiculteurs de multiplier les colonies, mais cela ne renseigne pas sur leur force, leur taux de survie, leur capacité à produire du miel. D’ailleurs, lorsque la production de miel est mauvaise, l’apiculteur peut être tenté, par la suite, d’augmenter le nombre de ses colonies pour compenser. »
Détailler les sources de financement
Informations compromettantes visant les personnalités critiques, argumentaires et éléments de langage prêts à l’emploi pour ferrailler sur les réseaux sociaux… l’arsenal mis à disposition de ses membres par Bonus Eventus ne s’arrête pas là. D’autres fiches – plus de trois mille – concernent des organisations non gouvernementales, des organismes de recherche publics, des fondations, des associations professionnelles, etc. Elles en détaillent les sources de financement, les personnalités-clés, les prises de position et les polémiques associées. On y trouve les plus célèbres, comme Greenpeace ou le Sierra Club – dont parlait déjà Jay Byrne dans son courriel de mars 2010 –, mais aussi des associations écologistes de taille bien plus modeste, comme la française Générations futures.
La presse n’y échappe pas. Le média d’investigation Lighthouse Reports, associé au Monde dans cette enquête et qui a noué des partenariats avec plus de 170 médias dans le monde entier, est par exemple lui aussi épinglé. Sa fiche le dépeint comme orienté, soupçonné de faire le jeu de la Russie, etc. Un élément de son financement est particulièrement mis en majesté, souligné dans les premières lignes de sa fiche : l’un des donateurs de Lighthouse Reports, l’Oak Foundation, finance également l’AgroEcology Fund, un fonds de soutien à des projets agroécologiques. Un lien présenté comme problématique, mais qui perd de son importance lorsqu’on sait que Lighthouse Reports est financé par 21 organisations différentes, l’Oak Foundation n’étant que l’une d’elles. Et que cette même Oak Foundation finance aussi des centaines de projets en lien avec le logement, les droits humains, le statut des femmes, l’éducation, etc.
Ce petit détail illustre le fonctionnement de Bonus Eventus, comme « ferme de contenus » et chambre d’écho, destinée à produire, répercuter et amplifier les mêmes éléments de langage. Dans sa réponse écrite au consortium pour cette enquête, Jay Byrne proteste sans surprise contre le fait que Lighthouse Reports « opère avec le soutien financier d’un donateur de l’AgroEcology Fund, l’Oak Foundation ».
Répondant aux questions du Monde sur ses liens éventuels avec Bonus Eventus, une journaliste française assure qu’elle n’en a pas, mais précise : « La campagne à laquelle votre projet d’article participe est financée par un donateur de l’AgroEcology Fund, un lobby consacré à la promotion des pratiques et des politiques agroécologiques. » Et quelques jours avant la publication de notre enquête, un blogueur inscrit sur Bonus Eventus, qui n’avait pas été contacté, publiait un billet dénonçant « les sommes non divulguées versées à Lighthouse Reports par de sombres groupes d’intérêt conseillés par des donateurs et cachés derrière des fonds tels que l’Oak Foundation ». Trois interlocuteurs, un même argument.
Le plus petit contenu critique compte
La dissémination de ce type d’information est minutieusement surveillée. Parmi les documents internes de Bonus Eventus consultés par Le Monde, une page recense des milliers de contenus en ligne divers, le plus ancien remontant à 2013. Chaque jour, une douzaine d’articles sont recensés, publiés sur une multitude de supports très divers, de la chaîne YouTube confidentielle aux pages « débats » de journaux internationaux.
Jay Byrne l’a théorisé de longue date : judicieusement placé, le plus petit contenu critique compte. Même les commentaires déposés par les lecteurs sur les espaces de discussion des sites de presse ont leur importance. En 2002, comme l’ont montré des correspondances rendues publiques par la justice, alors qu’il conseille la firme Syngenta dans la défense de son herbicide phare, l’atrazine, M. Byrne présente à son client sa « meilleure approche pour atténuer les retombées négatives de l’article attendu du New York Times sur l’atrazine ». Entre autres tactiques, il faut « encourager l’utilisation des opportunités de commenter l’article sur Nytimes.com ». « Il serait extrêmement bénéfique d’être les premiers à publier des commentaires » sous l’article en question, précise M. Byrne.
Lire aussi la tribune : Article réservé à nos abonnés « Le marché des pesticides dangereux est hautement rentable pour les firmes chimiques européennes »
Fidèle à cette ligne, Bonus Eventus indexe tout. Une partie des contenus recensés sont étiquetés « favorable » et disposent d’un tag supplémentaire, « crédit BE [Bonus Eventus] », suggérant que v-Fluence s’attribue le crédit de leur production ou de leur publication. Interrogé sur le sens à donner à cette mention, M. Byrneélude. « Nous avons des dizaines de catégories et des centaines de balises de codage pour organiser et distribuer le contenu, explique-t-il. Aucune de ces catégories n’exprime ou ne représente une quelconque relation ou influence sur les auteurs de contenu et les publications, ainsi que sur notre organisation ou nos clients. »
Campagne de dénigrement
Toutefois, la grande majorité de ces milliers de contenus étiquetés « crédit BE » relève de commentaires, de billets de blogs, de tribunes ou d’entretiens accordés à la presse, produits ou coproduits par des personnalités inscrites sur Bonus Eventus. On y distingueles angles d’attaque favoris de l’industrie des pesticides : une grande partie de ces contenus ciblent spécifiquement le Centre international de recherche sur le cancer, bête noire des géants de l’agrochimie.
Depuis 2015, cette agence de l’OMS, très attachée à son indépendance à l’égard des pouvoirs économiques, est la cible d’une campagne de dénigrement d’une virulence inédite, notamment pour avoir classé « cancérogène probable » le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé. Le Monde est également fréquemment mentionné : près d’une centaine de contenus référencés « crédit BE » s’en prennent à des articles ou à des journalistes du Monde.
(Re)lire notre enquête : Article réservé à nos abonnés « Monsanto papers » : la guerre du géant des pesticides contre la science
Parmi ces contenus « crédit BE », de nombreux ont été publiés par des auteurs ou des médias français. Le plus prolifique est un agronome à la retraite, André Heitz, qui tient un blog sous le pseudonyme « Wackes Seppi ». Il est l’auteur de plusieurs centaines de billets colligés par Bonus Eventus. Dans ses textes, « Seppi » s’en prend volontiers aux chercheurs travaillant sur les effets délétères des pesticides ou sur les conséquences indésirables de la transgenèse, ou aux journalistes qui relaient leurs résultats. Le ton y est vif : M. Heitz a été condamné en 2019 pour des faits d’injures publiques et de diffamation à l’encontre du journaliste Paul Moreira. Interrogé, l’agronome blogueur dit ne pas être membre du réseau piloté par v-Fluence, et assure avoir été simplement « invité à [s]’inscrire sur une liste d’informations ». Il ajoute ne percevoir aucune rémunération de quiconque pour ses billets.
D’autres sites comme Agriculture et Environnement ou European Scientist, tenus par des consultants, arrivent ensuite, avec chacun une centaine de contenus référencés « crédit BE ». Inscrits au registre de Bonus Eventus, leurs responsables respectifs, Gil Rivière-Wekstein et Jean-Paul Oury, assurent aussi n’avoir aucun lien d’aucune sorte avec le réseau piloté par v-Fluence. Interrogé, M. Rivière-Wekstein dit « revendiquer le titre de journaliste » eu égard à son activité éditoriale : « Plus de 1 300 articles, dont plus de deux cents éditoriaux », « cinq livres d’enquêtes journalistiques et plus d’une centaine de vidéos de décryptage et d’interviews ».
Lire aussi l’archive de 2017 : Article réservé à nos abonnés « Monsanto papers », désinformation organisée autour du glyphosate
En 2009, toutefois, l’avocat de M. Rivière-Wekstein avait plaidé devant la cour d’appel d’Angers que son client – poursuivi pour diffamation publique par Jean-Marc Bonmatin, un chercheur du CNRS spécialiste d’abeilles et de pesticides – s’exprimait « dans un cadre militant » et qu’« il ne pouvait lui être opposé les conditions fixées pour un journaliste professionnel chargé d’informer le public », selon l’arrêt de la cour. M. Rivière-Wekstein a finalement été condamné.
Activité éditoriale diffuse
De son côté, le site European Scientist a été épinglé, après des révélations de l’hebdomadaire Fakir, pour avoir publié des textes rédigés à la demande d’entreprises et proposés à la publication par des agences de communication, sous la signature de tierces partiesou des identités d’emprunt. « C’est une pratique transparente et répandue, répond M. Oury. Des agences parisiennes m’ont proposé des textes que je retiens (ou pas) sur le fondement de leur qualité éditoriale, sans argument d’autorité. »
Parmi les textes publiés sur ce site et référencés en catégorie « crédit BE », plus d’une dizaine sont signés par Philippe Stoop, consultant pour de grandes sociétés agro-industrielles, et… lui aussi inscrit sur Bonus Eventus. M. Stoop précise qu’il a souscrit un abonnement à la plate-forme en 2017 pour un service de revue de presse et qu’il ne participe à aucune activité particulière du réseau. Il ajoute : « Bonus Eventus ne m’informe pas quand mes publications y sont citées ou traduites, et ne m’a jamais rémunéré, ni suggéré un thème d’article. »
L’efficacité de cette activité éditoriale diffuse est difficile à saisir, mais elle est réelle. En avril, par exemple, la Société française du cancer a, selon nos informations, renoncé à endosser une tribune soumise au Monde sur les liens entre pesticides et cancer, après que certains de ses membres ont fait circuler en interne des billets de MM. Heitz et Stoop comme éléments de relativisation des risques réels présentés par ces substances.
Aucun journaliste français ne semble inscrit à Bonus Eventus. Mais le tableau des articles étiquetés « crédit BE » mentionne plusieurs titres de presse (Le Figaro, Les Echos, La Tribune, Valeurs actuelles, etc.) ayant publié quelques entretiens ou tribunes, dans la plupart des cas signés par des personnalités elles-mêmes inscrites sur Bonus Eventus. Seules exceptions : Le Point et L’Opinion,dont respectivement une douzaine et une quarantaine de papiers référencés « crédit BE » par la plate-forme de v-Fluence sont signés par des journalistes. Interrogées, les deux autrices de ces articles disent ne pas connaître cette plate-forme et n’avoir par conséquent aucun lien avec elle. Cette enquête a été menée conjointement avec Lighthouse Reports, The Guardian, The New Lede, The New Humanitarian, The Wire, The Continent, Africa Uncensored et ABC News Australia.