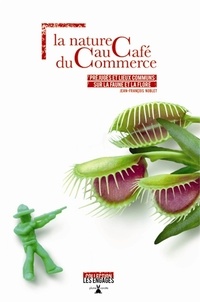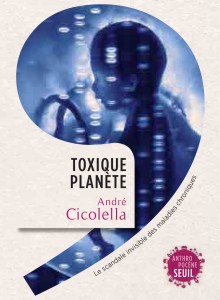Ce texte a été publié par Charlie Hebdo le 30 octobre passé. Mais il a été écrit le 24 du même mois, soit voici deux semaines. À cette date, pour ce que je sais en tout cas, nul ne parlait de l’un des dessous cinglés de l’affaire de l’écotaxe : la dévolution du contrat à Écomouv. C’est à cette aune, me semble-t-il, qu’il faut lire ce qui suit.
—————————————————————————-
Les paysans. Baladés par la droite, qui leur a fait miroiter formica, bagnole et télé, ils sont bananés par la gauche, qui poursuit sur la même route. Dernière trouvaille : l’écotaxe. Inventée par Sarkozy, elle plonge Hollande dans la fosse à lisier.
Le bordel ne fait que commencer, car l’écotaxe prélevée sur les camtars de plus de 3,5 tonnes ne peut pas être acceptée. Autrement dit, les manifs paysannes de la semaine dernière reprendront, sous une forme ou sous une autre, si le gouvernement ne modifie pas en profondeur le dispositif du nouvel impôt. Et s’il le fait, il sera encore un peu ridicule qu’il n’est, ce qui paraît presque impossible.
Mais reprenons dans l’ordre. En 2007, le grand Sarkozy réunit sur la photo une palanquée de dupes, pour la séance « Grenelle de l’environnement ». En 2009, le Parlement à sa botte vote à la suite une loi instituant une taxe sur les camions, qui devra s’appliquer en 2011, avant d’être retardée à 2012, puis 2013, puis janvier 2014. On en est là, et le très cocasse est bien sûr que la taxe est un pur héritage de Sarkozy, qui se foutait totalement et de l’écologie, et des pedzouilles, et de l’état des routes.
La bouffonnerie ne s’arrête pas là, car Sarkozy a laissé aux socialos un deuxième cadeau : Écomouv’. Sur le papier, cette charmante société écolo est chargée par l’État de « la mise en œuvre efficace et correcte du projet », ce qui ne semble pas tout à fait gagné. Nom du proprio d’Écomouv, qui n’est jamais qu’une filiale : Autostrade per l’Italia. Cette dernière, ritale comme son nom le suggère, a construit et gère une grande part du réseau italien d’autoroutes. Depuis 1999, elle fait partie de l’empire Benetton.
Et c’est là qu’on s’autorise un pouffement, car l’écotaxe mise en musique par Écomouv’ épargne totalement les autoroutes françaises. Imaginons un gros-cul de 38 tonnes espagnol qui va livrer ses fraises frelatées au Danemark, passant par l’A9, l’A7, l’A6, l’A4. Il ne paiera pas un rond de taxe, car seules sont concernées les routes nationales et départementales. En revanche, comme cela a été calculé, le bon couillon qui va livrer ses tomates de Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne) au marché de Rungis – la distance est de 40 kilomètres – devra banquer 15 euros. Hum, cela sent bon la grosse connerie.
En veut-on un peu plus ? Promenons-nous un trop court instant sur le site internet d’Écomouv’ (http://www.ecomouv.com). La pédagogie y est reine, et les explications sont par conséquent limpides. Par exemple, concernant la tarification : « Le réseau taxable est découpé en sections, à savoir des tronçons de route taxée compris entre deux intersections successives avec d’autres voiries publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l’une de l’autre, les sections de tarification peuvent faire l’objet d’un regroupement ».
Qui paiera ? Là encore, la joie domine le tableau. La facture sera acquittée par le routier, obligé de s’équiper d’un boîtier GPS relié à Écomouv’. Mais le payeur sera à l’arrivée le donneur d’ordre, car le transporteur répercutera intégralement le montant de la taxe sur la douloureuse. Est-ce bien clair ? Le tout est censé inciter les « acteurs économiques » à privilégier le transport fluvial ou le train, ce qui est évidemment une blague grandiose, puisque dans la presque totalité des cas, nul n’a le moindre choix. En 2011, la route représentait 88,3 % des transports de marchandises, contre 2,2 % par péniches et 9,5 % par le train.
Dans ces conditions délirantes, où ira le fric collecté ? L’écotaxe pourrait rapporter 1,2 milliard d’euros par an, ce qui n’est plus une goutte d’eau. En toute certitude, ce tas d’or ne servira pas à changer de système de transport. Mais comme le fisc a horreur du vide, on peut parier qu’une partie sera donnée aux collectivités locales pour éternellement refaire le macadam. Quant au reste, il y a d’autres trous à boucher, dans le budget général cette fois. On parie ?
Un dernier point qui laisse songeur. On se rappelle peut-être la privatisation des autoroutes sous le règne Chirac-Villepin, en 2005. Le cadeau fait à Eiffage, Vinci et Abertis était si somptueux qu’à l’époque, Bayrou y avait vu un vol pur et simple. Et il avait raison. La rente que l’État pourrait toucher chaque année avec les péages est grossièrement de 1,2 milliard d’euros. Comme cette foutue écotaxe.
Encadré
L’écœurement des pedzouilles
Honneur aux ancêtres. Dans L’identité de la France, livre paru en 1986, un an après sa mort, le grand historien Fernand Braudel raconte : « Le chambardement de la France paysanne est, à mes yeux, le spectacle qui l’emporte sur tous les autres (…) La population a lâché pied, laissant tout en place, comme on évacue en temps de guerre une position que l’on ne peut plus tenir ».
C’est simple : il y avait 10 millions d’actifs agricoles en 1945, sur une population de 40 millions d’habitants. Il en reste moins d’un million pour 66 millions d’habitants. Entre les deux, une entreprise parfaite, qui a conduit des millions de pedzouilles – surtout leurs enfants – des champs à l’usine, via la banlieue. Ce qu’on appelle le progrès.
Boostée par le plan Marshall en 1947, puis la volonté de « grandeur » chère à De Gaulle, à partir de 1958, l’industrialisation a totalement remodelé les campagnes, à coup de remembrement, de pesticides et de tracteurs. Il fallait produire pour nourrir, avant de produire pour faire du fric, par exemple avec les sinistres biocarburants.
Les pedzouilles ont avalé toutes les couleuvres. Ils ont intensifié, dégueulassé les sols et les eaux, et les voilà autant à poil que l’Empereur du conte d’Andersen. La Bretagne, que Pisani avait promis en 1965 de transformer en « atelier à viande et à lait », est proche de la faillite. On parlait d’un « miracle économique », et voilà qu’on découvre un vaste désastre écologique. Les pedzouilles sont endettés, écœurés. L’écotaxe, bâclée, jamais expliquée, est la goutte d’eau de trop. On les plaint ? Ouais, quand même, on les plaint.