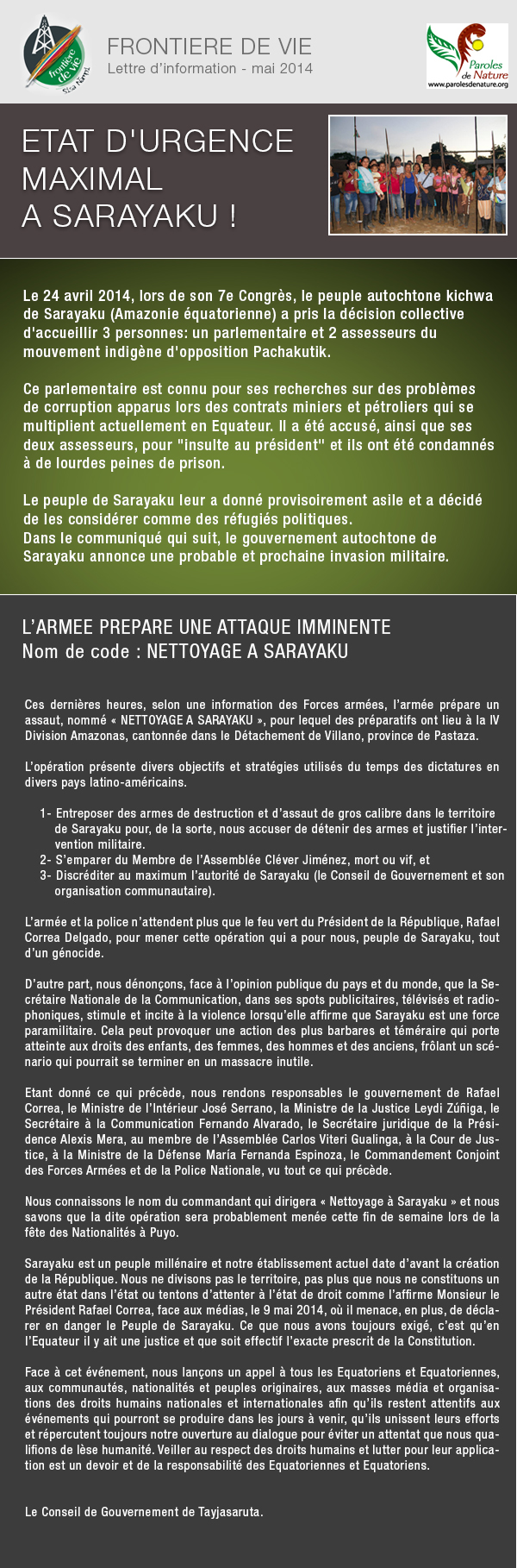Cet article a été publié par Charlie Hebdo le 14 mai 2014
Et si la crise climatique était l’une des causes cachées du soulèvement syrien et des révolutions arabes ? Une pluie d’études montre que l’on a trop longtemps ignoré les fondements écologiques des guerres et des révolutions. Faut que ça change.
Ne plus avoir d’eau. Moins pour les hommes, plus pour les bêtes, plus pour la terre. En 2006, la Syrie connaît une première sécheresse, qui passe inaperçue. Le pays est aride – 45 % est même désertique – et dans les années « moyennes », il n’y pleut qu’entre 200 et 400 mm, contre 750 en France, avec des pointes de plus de 1100 dans une ville comme Brest.
En 2007, tout recommence, en pire. En 2008, tout recommence, en pire. Une situation qui, d’après l’ONU, n’a pas été vue depuis quarante ans. Mais entre-temps, la population est passée de 6 millions à 20, dont beaucoup, installés en ville, ont des exigences nouvelles. À la fin de l’été 2008, au moins un million de paysans et de bergers sont dans la détresse hydrique. Selon des estimations ridicules, mais officielles, 59 000 éleveurs ont perdu la totalité de leur cheptel, mort de soif. En 2009, tout recommence, en pire : 300 000 habitants de l’Est et du Nord-Est – autrefois le grenier à blé – quittent leurs terres, probablement à jamais, et s’installent à Damas, à Alep, à Deir ez Zor. En 2010, tout recommence, en pire : les exilés sont au moins 500 000. La récolte du blé passe de 4,1 millions de tonnes en 2007 – pour tout le pays – à 2,4. Or les Syriens ont besoin d’à peu près 4 millions de tonnes.
Là-dessus, la guerre civile, qui débute au printemps 2011, et une question qui tombe sous le sens : pourrait-il y avoir des liens entre sécheresse et révolte ? Le 27 janvier 2014, la chercheuse néerlandaise Francesca de Châtel publie un article éclairant dans la revue Middle Eastern Studies (1), qui permet de voir la Syrie tout autrement. Oublions un instant les djihadistes, les alaouites, les chiites, les sunnites, le Hezbollah libanais. La Syrie n’a-t-elle pas besoin avant tout d’eau ? De Châtel ne conteste pas l’existence de facteurs sociaux et politiques, mais juge que la question de l’eau les a influencés et a pu être modifiée par eux.
Comme tant d’autres ailleurs, le régime n’a rien vu venir, perdu dans ses rêveries de toute-puissance et d’expansion sans limites. Quand Assad le père – Hafez – arrive au pouvoir en 1970, 7,5 % de la surface agricole est irriguée. En 2006, on dépasse les 25 %. Dans son article, de Châtel met davantage en cause la gestion politique de la sécheresse par Damas que le phénomène lui-même. Le clan Assad, qui mise désormais sur la libéralisation à tout crin et la fin des aides publiques, aurait tout simplement laissé jouer le marché – le prix du fourrage double en quelques mois -, condamnant ses paysans les plus pauvres à l’exil intérieur.
Le dérèglement climatique expliquerait-il les sécheresses à répétition ? Le scénario est conforme aux prévisions régionales, mais de Châtel s’y intéresse d’autant moins que Bachar, le maître de Damas, tente de tout mettre sur le dos du climat, qui serait le seul responsable du désastre. Un autre travail passionnant permet en revanche de poser de nouvelles questions sur l’éventuelle dialectique entre changement climatique et le phénomène connu sous le nom de « révolutions arabes ». Publiée en février 2013 par un think tank américain proche des Démocrates – le Center for American Progress (2) -, l’essai à plusieurs voix ouvre sur un monde inconnu.
On connaît la vulgate répétée de télé en radio depuis des années. Un vendeur ambulant tunisien, Mohamed (Tarek) Bouazizi, s’immole par le feu le 17 décembre 2010 dans la petite ville de Sidi Bouzid. De proche en proche, magnifiée par les réseaux sociaux, la révolte gagne toute la Tunisie et plusieurs pays arabes, dont l’Égypte. Mais n’a-t-on pas oublié en route l’importance décisive du climat et de l’alimentation ?
Les auteurs ne font pas plus dans le simplisme que de Châtel. Les changements en cours du climat ne sauraient être la cause des changements de régime, mais leurs conséquences peuvent avoir allumé la mèche, faite des causes habituelles. Et ils reprennent à leur compte l’expression « threat multiplier » : la crise climatique serait un multiplicateur de menaces. L’extrême sécheresse de 2010 en Chine, qui a renchéri le prix du blé sur le marché mondial, a évidemment eu des répercussions sur l’Égypte, plus grand importateur de blé de la planète. D’une manière générale, les pays arabes sont fragiles, car ils disposent de peu de terres cultivables et de peu de ressources en eau, ce qui contraint la plupart à devoir importer entre 25 % et 50 % de leur consommation de céréales. En pointant des relations auxquelles le regard n’est pas habitué, comme celle entre la place Tahrir et la place Tienanmen, on court le risque d’être chahuté, voire ridiculisé par les chercheurs plus classiques, de loin les plus nombreux.
Et il est vrai qu’aucune preuve, au sens scientifique comme au sens policier, ne peut être apportée. Deux des rédacteurs de ce travail, Sarah Johnstone et Jeffrey Mazo concluent par ces mots : « Le printemps arabe se serait probablement produit d’une manière ou d’une autre, mais le contexte dans lequel il s’est produit n’est pas sans conséquences. Le réchauffement climatique n’a peut-être pas provoqué le Printemps arabe, mais il peut l’avoir fait arriver plus tôt ».
Ce n’est pas la première fois que des chercheurs – encore rares – s’intéressent aux liens pourtant puissants entre conditions écologiques et crises humaines paroxystiques. Aux Amériques, l’universitaire canadien Thomas Homer-Dixon – très connu, il a dirigé différents instituts traitant ce sujet – publie le 31 janvier 1992 (dans le New York Times) un article que beaucoup tiennent là-bas pour pionnier. Clinton vient d’être élu pour un premier mandat, et Homer-Dixon l’invite à agir au plus vite. S’appuyant sur les exemples du Bangladesh, de la Chine, des Philippines, d’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Mauritanie, du Pérou, d’Haïti, il constate que « les pénuries de ressources renouvelables contribuent déjà à des conflits violents dans de nombreuses parties du monde en développement ». Et il ajoute plus loin : « Nous comprenons maintenant que [ces pénuries] produisent souvent des effets sociaux cachés et cumulatifs, comme les grandes migrations et des troubles économiques. Ces événements peuvent entraîner des affrontements entre groupes ethniques ainsi que des conflits civils et insurrectionnels ».
Dix ans plus tard, la guerre civile du Darfour semble bien lui donner raison. En 2003 commence dans l’ouest du Soudan – le Darfour – une guerre atroce entre les Janjawids et des tribus comme les Four, Massalit et Zaghawa. Les premiers sont des miliciens noirs arabisés, souvent nomades, les seconds des paysans sédentaires, noirs eux aussi.
La guerre devient si démentielle que, dès 2004, le Congrès américain la désigne comme un génocide, ce qui demeure contesté. Le fait est que le climat a changé entre le Nil et le lac Tchad. Le chercheur Jérôme Tubiana résume ainsi (3) l’état des lieux : « Au cours des quarante dernières années, [la région] a connu des vagues intenses de sécheresse, des précipitations de plus en plus variables et une diminution générale de la durée de la saison des pluies. On estime qu’au Darfour les températures ont déjà augmenté de 0,7°C entre 1990 et 2005 ».
En 2007 (le 16 juin), le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon se paie une tribune retentissante dans le Washington Post. « Si la violence a éclaté au Darfour pendant la sécheresse, écrit-il, ce n’est nullement par hasard. Jusque-là, les bergers nomades vivaient tranquillement au contact des agriculteurs sédentaires. Un récent article décrit la manière paisible dont les agriculteurs partageaient leurs puits et accueillaient les éleveurs qui sillonnaient le pays en faisant paître leurs chameaux. Mais quand les pluies ont cessé, les agriculteurs ont clôturé leurs terres de peur qu’elles ne soient ravagées par les troupeaux ».
Est-ce aussi clair que semble le penser Ban Ki-moon ? Le Darfour a donné lieu, dans les marges, à des débats de grande qualité. Ainsi cet article inspiré du chercheur Marc Lavergne (CNRS, Groupe d’études et de recherches sur la Méditerranée et le Moyen-Orient), publié dans Revue Tiers Monde (Le réchauffement climatique à l’origine de la crise du Darfour ?). S’interrogeant sur les liens entre déplacés et mouvements de population d’une part, dérèglement climatique d’autre part, il note : « Le réchauffement climatique fait (…) office de facteur déterminant d’explication de ces mouvements de population. Cette « récupération » (…) peut conduire à des schématisations outrancières, voire à des erreurs permettant d’évacuer les responsabilités des acteurs effectivement à l’origine des crises ou des conflits ».
De fait, les autorités de Khartoum – la capitale soudanaise – ont surabondamment exploité l’explication « climatique ». Car non seulement elle masque leurs écrasantes responsabilités, mais elle fait retomber la faute historique sur les sociétés du Nord, qui sont bel et bien le déclencheur de la crise climatique. Mais malgré l’excellence des autres arguments avancés par Lavergne, il ne fait pas de doute que le climat devient une question politique majeure, au Darfour comme ailleurs.
La revue bien connue Science publiait le 1er août 2013 une méta-analyse portant sur 60 études publiées et 45 conflits (4). Le résultat – controversé – montre une corrélation évidente entre des événements climatiques parfois mineurs et l’irruption de conflit. À toutes les échelles spatiales et temporelles. On passe des violences domestiques à cause d’une canicule aux meurtres sur fond de sécheresse, des révoltes paysannes à l’effondrement de civilisations comme celles de Mésopotamie ou des Indiens mayas. Une fois encore, les auteurs – Solomon Hsiang, Marshall Burke, Edward Miguel – insistent sur les limites de leur travail. Le climat, en toute hypothèse, viendrait se surajouter à des causes plus coutumières, et ne serait pas nécessairement la cause principale des affrontements entre humains.
Corrélation ne veut pas dire explication. Mais le chantier qui vient de s’ouvrir ne fermera pas de sitôt. Selon des extrapolations tirées de cette dernière publication, le risque de guerre civile pourrait augmenter de 50 % dans un grand nombre de pays au cours des prochaines décennies.
(1) The Role of Drought and Climate Change in the Syrian Uprising: Untangling the Triggers of the Revolution
(2) The Arab Spring and Climate Change
(3) In « Darfour-Tchad : s’agit-il de la première guerre du climat ? »
(4) Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict
———————————–
Entre récoltes et génocide
Faut-il ajouter le climat aux autres facteurs expliquant le génocide rwandais de 1994 ? En 1984 et surtout 1989, des sécheresses graves ont en tout cas frappé le pays et provoqué des famines. Avec entre les deux, les pluies surabondantes de 1987, détruisant les cultures de pommes de terre, de haricots et de maïs.
La suite n’est pas plus réjouissante. Dans un article publié en 1996 (Climat et crise rwandaise), l’agrométéorologue de la FAO René Gommes rapproche les conditions climatiques locales et la tenue des massacres. À l’automne 1993, quelques mois avant le début des tueries, « les pluies de septembre et d’octobre sont très faibles et conduisent à une réduction notables des rendements et des surfaces plantées. La première récolte de haricots est perdue, et les pluies insuffisantes ne permettent pas de replanter ». En mars 1994, quelques semaines avant l’embrasement, c’est pire, car des centaines de milliers de réfugiés du Burundi aggravent une situation alimentaire devenue critique. « Dans le nord, le déficit de production est du à la sécheresse et à des déplacements massifs de population (…) Le sud a été particulièrement affecté par la sécheresse et la population est confrontée à des déficits alimentaires de proportions très inhabituelles. On signale des morts dus à la famine ».
Une autre question, totalement ignorée, pourrait avoir joué un rôle : l’érosion des sols. Dès 1992, l’agronome allemand Dieter König alerte sur la disparition du sol arable sous l’action des pluies : « Au Rwanda, écrit-il, les dégâts d’érosion peuvent être observés partout. La plupart des collines sont complètement déboisées et intensément cultivées ». 100 tonnes de sol par hectare, selon König, disparaissaient chaque année, à jamais. Rappelons que le Rwanda est un pays de 26 000 km2 – la Bretagne en fait 34 000 -, dont la population est passée de 1 830 000 habitants en 1949 à 6 750 000 en 1990, soit près de quatre fois plus. Juste avant le génocide, la densité de population pouvait atteindre 500 habitants par km2 à la campagne, conduisant les paysans à défricher toujours davantage. Un cercle vicieux menant à l’épuisement accéléré des sols et donc à une baisse des rendements de cultures vitales pour l’alimentation, comme le sorgho, les petits pois ou les haricots.
Pour le Rwanda comme pour d’autres pays, l’évocation de causes autres que politiques, sociales, économiques peut hérisser le poil. Le livre de l’Américain Jared Diamond « Effondrement » (Gallimard, 2006) concentre les critiques, car l’auteur y écrit notamment : « La population rwandaise a augmenté à un taux moyen de plus de 3 % l’an (doublement en moins de 24 ans). Le développement économique du Rwanda fut stoppé par la sécheresse et l’accumulation de problèmes environnementaux. Le pourcentage de la population consommant moins de 1600 calories par jour (niveau en dessous de celui de la famine) était de 9 % en 1982, 40 % en 1990. D’où le génocide en 1994. Il n’est pas rare, depuis, d’entendre des Rwandais soutenir qu’une guerre était nécessaire pour diminuer une population en excès et pour la ramener au niveau des ressources en terre disponibles. »